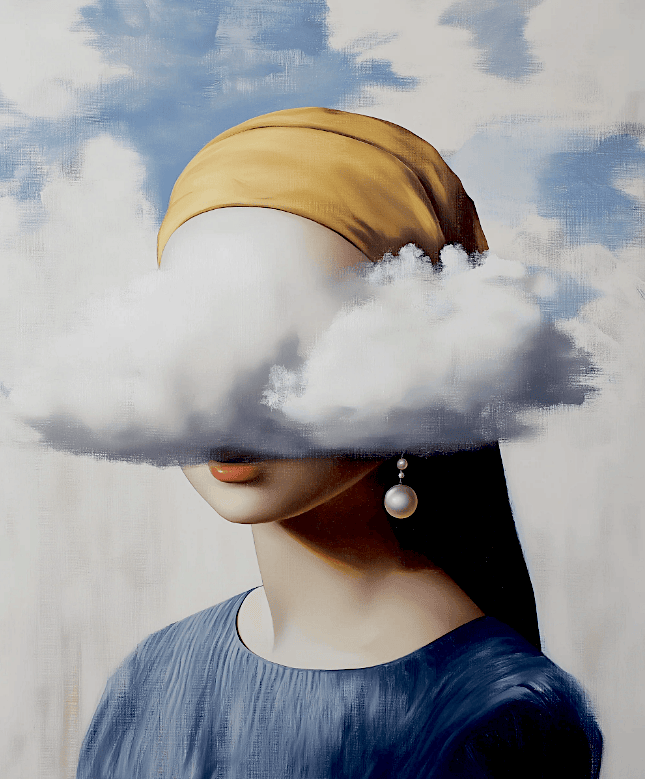En allant étudier la démocratie en Amérique, Alexis de Tocqueville souhaitait observer d’un point de vue distancé le régime issu de la Révolution de 89 qui avait du mal à s’imposer. Dévié en Empire par Napoléon, interrompu par des retours à la monarchie, la démocratie française montrait une fragilité toute particulière. En Amérique, en revanche, n’étant précédée d’aucune monarchie, la démocratie était le fruit d’une insurrection d’individus, égaux par leur statut de colonisés, contre des colons situés de l’autre côté de l’Océan. Ce souhait de Tocqueville était accompagné d’un autre. Soumettre à l’épreuve des faits son hypothèse selon laquelle la montée de la revendication d’égalité est un phénomène social irréversible.
Ignorant les privilèges aristocratiques, les Américains avaient une représentation de la liberté et de l’égalité dépourvue de préjugés sociaux. Identifiant l’égalité garantie par les lois avec la possibilité d’améliorer leurs conditions sociales, ils usaient de leur liberté pour accéder aux situations existantes ou pour entreprendre quelque chose de nouveau. L’inégalité intellectuelle, « qui vient directement de Dieu », était compensée par la possibilité d’acquérir des biens matériels et de disposer ainsi de pouvoirs importants au sein de la société. Se pensant tous ”semblables” et misant sur la mobilité sociale, les Américains n’élevaient pas de barrière sociale entre le patron et l’ouvrier. La richesse était pour tous un objectif à atteindre, non un critère de valeur.
Par opposition, la démocratie française, lestée par l’héritage monarchique, en reproduisait les travers. Centralisatrice, méfiante à l’égard des détenteurs du pouvoir, accordant grande valeur aux titres décernés par les organismes nationaux, elle manquait de clarté sur ses propres fondements et ambitions. Dans le sillage de Tocqueville, Hannah Arendt avance une remarque pertinente. Visant avant tout la libération d’un peuple du joug de l’absolutisme et tendue par cette lutte, la Révolution française a confondu « libération » et « liberté ». Aussi, n’a-t-elle pas permis l’incarnation des conditions de la liberté politique étudiées par les penseurs des Lumières.
Ces pensées pourraient nous éclairer sur la situation actuelle de la démocratie française, marquée par la médiocrité de ses représentants de tous bords. Il y est sans cesse question d’une égalité irréfléchie et d’une lutte permanente ”contre” l’oppression des injustices. Il n’y a guère de discussion mais du ”débat/combat” entre préjugés. La liberté y est vécue comme le droit de “tout déballer” sans égard ni aux faits ni à la civilité. Le tout dans l’indifférence pour le bien commun sans lequel les intérêts particuliers ne sauraient trouver satisfaction. Peut-on encore parler de ”vie politique” quand il s’agit de ”mettre à mort” ses rivaux dans une poursuite aveugle du pouvoir pour le pouvoir ?